- Teks
- Sejarah
J'ignore absolument si l'on s'est o
J'ignore absolument si l'on s'est occupé des Maporais, n'ayant jamais trouvé leur nom dans aucune relation de voyage ni autre livre. On aura probablement pensé qu'ils n'en valaient pas la peine.Mapor est uns kampong (village) situé sur la frontière septentrionale du district de Soengeiliat, avec celui de Blinjoe; dans l'île de Banka.
Les habitants de ce kampong ne seraient pas originaires de l'île; mais, d'après une vieille légende, représenteraient les- descendants de l'équipage d'une jonque cochinchinoise, qui a péri sur la côte de Banka, à l'embouchure du Soengei-Mapor (rivière de Mapor). On n'a aucune donnée sur l'époque de l'arrivée de cette jonque. L'équipage, n'ayant pas les moyens de retourner dans son pays, se serait fixé près de la côte, dans le kampong de Mapor; cependant, il n'est pas dit s'ils ont fondé ce kampong ou non, et, en s'unissant à des femmes du pays, s'ils ont donné naissance à la tribu des Ma
Ce n'est qu'après l'émeute d'Amir, en 1850, qu'on a force la population de quitter ses ladangs et de se réunir dans des kampongs, le long des grandes routes. J'ignore si Mapor a été dans le même cas ou non.La raison pour laquelle les Bankanais préféraient vivre surleurs ladangs, au lieu de se réunir en communauté, était, outre la commodité qu'ils trouvaient d'habiter là où ils cultivaient leur riz en satisfaisant ainsi à i leur paresse innée, la écumeurs de mer venait, de l'archipel de Solo et de Mindanao, dans l'île de Banka, pour enlever un plus ou moins grand nombre de personnes, surtout des femmes et des filles, qu'ils réduisaient en esclavage. Il est clair que, dans les bois, la population était plus à l'abri de ces invasions que dans les villages, étant donné que le Bankanais n'a pas le courage de défendre ni son bien, ni sa personne, contre les attaques de qui que ce soit.
Les Maporais ne ressemblent pas beaucoup aux Bankanais; ils sont plus grands, d'une constitution plus forte, plus éner giques, et, signe distinctif, bien plus braves. Le Bankanais pur sang se nourrit exclusivement de riz, noir ou rouge, de grain et de poisson; il ne mange que bien rarement de la viande, parce qu'il n'y a pas de bêtes domestiques autres que les porcs des Chinois, auxquels sa religion lui défend de toucher; ce n'est que 'quand il parvient à prendre un cerf ou un daim, dans ses filets, qu'il peut sepermettre le luxe de manger un morceau de viands. Le Maporais, au contraire, mange tout ce qu'il peut se procurer : du sanglier, du serpent, des grenouilles, du crocodile. Il cuit ou rôtit sa viande ou son poisson, comme les autres indigènes, et en mange autant qu'il peut. Comme tous les habitants de l'archipel malais, il est d'une grande imprévoyance, et ne fera jamais de provisions (excepté le riz qu'il cultive) ; la mer et la forêt lui fourniront, d'ailleurs, toujours du poisson et du gibier en abondance.
porais actuels. La supposition d'après laquelle ils se seraient fixés dans le kampong de Mapor. n'est peut-être pas tout à fait exacte, car autrefois il n'y avait pas de village, à proprement dire, dans l'île de Banka; chaque famille allait demeurer dans les bois, sur son ladang (rizière non irriguée), et changeait tous les deux ou trois ans de domicile, de telle sorte qu'on ne savait jamais trouver les personnes dont on pouvait avoir besoin.
Les substances enivrantes et excitantes ne leur sont guère connues, à l'exception du tabac, qu'ils fument en cigarettes ou dans des pipes en bois (bambou) ou en métal ; ces der nières sont de fabrication chinoise.
L'opium, cette immense plaie des Orientaux, est trop cherpour la pauvre population de Banka,et surtout pour le Maporais. Le Maporais est beaucoup moins sensible à la douleur physique que les autres indigènes de l'île. Je ne saurais dire si les autres sens sont plus ou moins développés, parce qu'il est très difficile d'entrer en communication d'idée avec eux ; ils sont si peu développés qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Ils diffèrent, en tout cas, beaucoup des peuples plus civilisés, sous le rapport de la sensibilité olfactive, car ils supportent les odeurs les plus nauséabondes avec la plus grande placidité.
Ils ne portent ordinairement aucune espèce de parure, ni même de vêtements, à l'exception d'un petit morceau de cotonnade, ou même d'écorce d'arbre, en forme de tablier, pour couvrir. les parties sexuelles. Ce tablier est un peu plus grand chez les femmes que chez les hommes, sans pour cela cacher beaucoup leur nudité. J'ai cependant vu quelques femmes avec des boucles d'oreille, et des enfants avec uncollier en grossières perles de verre ou de coquillages. Letatouage n'existe pas parmi eux.
Ils n'ont besoin d'aucune déformation ni mutilation pour être laids. Le beau sexe surtout est bien vilain. Ni danse, ni instrument de musique, ne sont en usage parmi eux; ils ont cependant une espèce de chant monotone et peu agréable à l'oreille, qui les aide à marcher en cadence, lorsqu'ils portent des fardeaux à plusieurs. Comme les autres indigènes de l'archipel, ils aiment leurs enfants et ne les maltraitent pas trop, ni leurs femmes non plus, sans avoir pour cela une trop grande tendresse pour elles. Ils ont le respect des vieillards. Ce sont surtout les femmes qui portent les charges les plus lourdes ; elles sont, en général, très recherchées comme porteuses de palanquin, parce qu'elles ont la marche sûre et légère, et qu'elles sont réellement infatigables.
Si les Maporais ont un culte quelconque, il doit être des plus primitifs, car on ne s'en aperçoit pas du tout. Seuls des indigènes de Banka, ils ne sont pas musulmans et mangent du porc ; c'est pour cette raison qu'ils sont généralement
méprisés. J'ignore s'ils font des sacrifices ou des offrandes, mais je ne le crois pas. Ils enterrent leurs morts sans grandes cérémonies. Je ne suis pas bien certain qu'ils croient à une vie future, mais ils ont une certaine idée d'un génie bienfaisant ou malfaisant, selon les circonstances. On ne peut pas dire qu'ils sont indifférents en matière religieuse, je crois plutôt qu'ils n'y pensent pas du tout, car ils n'ont ni prêtre, ni culte, ni temple, ni prière. Ils vivent assez bien en famille, et s'occupent de leurs enfants pour les nourrir. L'héritage n'existe pas, parce qu'ils ne possèdent rien.
Les passions contre nature sont généralement peu connues des indigènes de l'archipel malais. Quoique cela n'ait aucun rapport directs avec- les Maporais, il est à remarquer qu'en général les femmes malaises et javanaises ont un sentiment de pudeur, je dirais plutôt de convenance hygiénique, qu'on ne rencontre que rarement chez les femmes européennes; ainsi, aucune de ces femmes ne se donnera jamais ni à son mari, ni même à son amant, pendant la gestation ou l'allaitement, parce qu'elles disent : “Cela nuirait à mon en fant”.
Quoique la polygamie soit légalement permise à la population de la Malaisie, elle n'est guère pratiquée que par les riches, qui ne sont pas nombreux; le couli ou le petit cultivateure ne peut pas se permettre le luxe de nourrir plus d'une femme; il en est de même des Maporais.
Si les filles à marier manquent dans son village, le Maporais trouve difficilement une compagne, non seulement parce qu'il est trop pauvre pour payer une dot, mais plutôt parce qu'il est méprisé comme kafir, qui mange des bêtes impures. Il est donc bien forcé, s'il veut se marier, d'enlever une femme ou une fille d'un autre village, ce qui n'entraîne ordinairement pas des conséquences bien funestes, parce que le Bankanais est trop lâche, soit pour .venger son honneur, soit pour défendre ou reprendre sa fille à son ravisseur. Je dois ajouter que ces femmes se trouvent rarement malheureuses, et qu'elles ne réclament pas trop contre la violence qu'elles ont eu à subir.
L'esclavage étant aboli aux Indes néerlandaises, depuis le 1er janvier 1860, il n'y a donc plus d'esclaves à Banka. Les rapports des Maporais avec les représentants du gouvernement sont des plus faciles ; ils exécutent les travaux; qu'on leur ordonne de faire, et payent les impositions, de manière qu'ils ne donnent jamais lieu à des plaintes sérieuses. Comme leur nombre ne dépasse pas quelques centaines, ils se connaissent tous par leurs noms, et n'ont donc besoin ni d'un (totem ), ni de signe de reconnaissance. Ils n'ont pas d'autre industrie que la chasse, la pêche et la culture des ladangs. Il servent, la plupart du temps, comme porteurs de palanquin.
Par ladang, on entend les rizières non irrigables qui dépendent uniquemeut de la pluie. Pour établir les ladangs, on coupe les broussailles et les arbres qui ne sont pas trop gros sur une étendue voulue; on laisse sécher, ce bois coupé pendant quelques mois, puis, après y avoir mis le feu quelques jours avant les premières pluies, on sème le riz dans lescendres refroidies. Si la pluie vient, et qu'il plaise à Allah, on aura une abondante moisson d'un riz qui. n'est pas si appétissant, mais bien plus nutritif, que celui que l'on récolte dans les rizières irrigables (sawa). L'inconvénient de cette culture est, outre le pénibletravail de couper le bois, une destruction déplorable souvent de grandes étendues de bois précieux pour ne récolter, en somme, que, quelques sacs de riz. Par suite, le pays se dé boise, et les pluies deviennent plus rares et moins abonndantes.
Le gouvernement a déjà essayé d'introduire la culture des, sawa à Banka; mais on a commis la faute de ne pas defendre l'établissement des ladangs une fois pour toutes, ce qui aurait naturellement coûté de l'argent, parce qu'il aurait fallu importer du riz et le fournir à un prix au-dessous du prix de revient, pendant au moins trois ans. En fait, d'animaux- domestiques, le Maporais a quelques poules, et quelquefois un chien. Pour la pêche, ils se servent de la ligne et d'un filet tricoté par eux-mêmes. La chasse au sanglier est faite au moyen de fosses caches et recouvertes légèrement, dans lesquelles on place un appât quelconque. Les cerfs sont pris dans de grands filets en
5000/5000
Aku benar-benar tidak tahu jika hal itu berhubungan dengan Maporais, tidak pernah setelah menemukan nama mereka tidak perjalanan hubungan atau buku lainnya. Itu akan mungkin berpikir bahwa mereka bukanlah hukuman.Mapor adalah setiap Kampung (desa) terletak di perbatasan utara distrik Soengeiliat, dengan Blinjoe; di Pulau Banka.
Penduduk kampung ini akan tidak berasal dari pulau; tetapi berdasarkan sebuah legenda lama, mewakili - keturunan awak cochinchinoise sampah, yang tewas di pantai Banka, di mulut Soengei-Mapor (Mapor sungai). Ada tidak ada data pada saat kedatangan sampah ini. Kru tidak memiliki sarana untuk kembali ke negerinya, akan mengatur diri mereka sendiri di pesisir, di Kampung Mapor; Namun, tidak dikatakan jika mereka telah mendirikan Kampung ini atau tidak, dan, dalam menyatukan perempuan negara, jika mereka melahirkan suku saya
adalah bahwa setelah kerusuhan Amir pada tahun 1850, kita memaksa penduduk meninggalkan Nya ladangs dan bertemu di Kampung, sepanjang jalan utama. Aku tidak tahu apakah atau tidak Mapor telah dalam kasus yang sama.Alasan mengapa Bankanais pilihan hidup surleurs ladangs, bukan untuk bertemu di masyarakat, adalah, selain kenyamanan bahwa mereka menemukan tinggal di sana mana mereka dibudidayakan nasi mereka sehingga memuaskan kemalasan mereka bawaan, laut skimmers saya datang, Solo dan Mindanao, di Pulau Banka, Kepulauan untuk menghapus sejumlah besar atau lebih kecil orang, terutama wanita dan anak-anak, yang mereka dikurangi perbudakan. Jelas bahwa, di hutan, kota ini memiliki penduduk lebih terlindung dari serangan-serangan ini di desa-desa, menjadi mengingat bahwa Bankanais telah tidak berani membela atau properti atau pribadinya, terhadap serangan apapun.
Maporais tidak terlihat seperti banyak Bankanais; mereka lebih besar, sebuah konstitusi yang lebih kuat, lebih ener strategis, dan berbeda tanda, lebih berani. Bankanais darah murni feed secara eksklusif pada beras, hitam atau merah, biji-bijian dan ikan. Ia hanya makan meskipun jarang daging, karena tidak ada hewan domestik lain daripada babi dari Cina, agama yang ia membela sentuhan; adalah bahwa ' ketika ia berhasil mengambil rusa atau rusa di jaring yang dapat sepermettre kemewahan makan sepotong daging. Maporais, sebaliknya, makan semua yang ia bisa mendapatkan: babi hutan, ular, katak, buaya. Itu dimasak atau daging panggang daging atau ikan, seperti pribumi lainnya, dan makan sebanyak yang ia bisa. Seperti semua orang Nusantara, ada kekurangan besar Tinjauan ke masa depan, dan tidak pernah akan membuat ketentuan (kecuali beras tumbuh); laut dan hutan akan menyediakan, Selain itu, selalu ikan dan game dalam kelimpahan.
porais saat ini. Asumsi bahwa mereka akan tetap di Kampung Mapor. ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena sebelumnya ada no desa, sebenarnya mengatakan di Pulau Banka; setiap keluarga akan tetap berada di hutan, di ladang (non-irigasi sawah) nya, dan berubah setiap dua atau tiga tahun rumah, jadi kami tahu tidak pernah menemukan orang-orang yang bisa membutuhkan.
Menarik dan memabukkan zat hampir tidak dikenal mereka kecuali tembakau, mereka asap rokok atau pipa logam atau kayu (bambu); Terakhir der ini adalah manufaktur Cina.
opium, sakit ini besar orang Timuran, juga cherpour penduduk miskin Banka, dan khususnya untuk Maporais. Maporais jauh lebih sensitif terhadap rasa sakit fisik daripada pribumi lain pulau. Saya tidak tahu jika indera yang lain lebih atau kurang berkembang, karena sangat sulit untuk masuk ke dalam komunikasi ide dengan mereka. mereka begitu buruk dikembangkan bahwa mereka tidak mengerti mereka diminta. Mereka berbeda dalam setiap kasus, orang-orang jauh lebih beradab. di bawah laporan penciuman kepekaan, karena mereka mendukung lainnya bau dengan terbesar placidity
mereka biasanya tidak membawa jenis perhiasan, atau bahkan pakaian, dengan pengecualian sepotong kecil kain katun, atau bahkan kulit pohon, berbentuk daun, untuk menutupi. Bagian seksual. Celemek ini sedikit lebih besar di antara perempuan daripada di antara pria, tanpa begitu banyak menyembunyikan ketelanjangan mereka. Namun, saya melihat beberapa wanita dengan anting-anting, dan anak-anak dengan uncollier di kasar manik-manik kaca atau kerang. Letatouage tidak ada diantaranya.
mereka butuhkan tanpa distorsi atau mutilasi menjadi jelek. Seks lebih adil terutama jelek. Tari maupun alat musik yang digunakan antara mereka; Namun, mereka memiliki semacam monoton dan bagus sedikit bernyanyi di telinga, yang membantu mereka berjalan irama, ketika mereka membawa beban ke beberapa. Seperti lain penduduk asli kepulauan, mereka mencintai anak-anak mereka dan tidak menyalahgunakan mereka terlalu banyak, atau mereka istri baik. tanpa harus melakukan ini satu kelembutan terlalu banyak bagi mereka. Mereka memiliki rasa hormat untuk orang tua. Ini adalah sebagian besar wanita yang menanggung beban terberat; mereka adalah, secara umum, sangat dicari sebagai pembawa tandu, karena mereka memiliki pasar Brankas dan cahaya, dan mereka benar-benar tak kenal lelah.
jika Maporais kultus, harus paling primitif,. karena kita semua bisa melihat. Penduduk asli Banka saja, mereka tidak Muslim, makan daging babi; untuk alasan ini, mereka adalah biasanya
dibenci. Aku tidak tahu jika mereka membuat korban atau persembahan, tapi aku tidak. Mereka menguburkan orang mati tanpa upacara besar. Saya tidak yakin bahwa mereka percaya dalam kehidupan masa depan, tetapi mereka memiliki ide jenius bermanfaat atau berbahaya, tergantung pada keadaan tertentu. Mustahil untuk mengatakan bahwa mereka tidak peduli dalam hal keagamaan, aku agak percaya bahwa mereka berpikir sama sekali, karena mereka memiliki imam, ibadah, Candi maupun doa. Mereka hidup cukup baik dalam keluarga, dan mengurus anak-anak mereka untuk memberi makan. Warisan tidak ada, karena mereka memiliki apa-apa.
nafsu unholy umumnya sedikit dikenal penduduk asli Kepulauan Melayu. Meskipun tidak ada hubungan langsung dengan - telah Maporais, perlu dicatat bahwa pada umumnya perempuan Melayu dan Jawa memiliki rasa kerendahan hati, aku akan mengatakan bukan kenyamanan higienis, kita bertemu jarang di Eropa perempuan; Dengan demikian. Tak satu pun dari wanita-wanita ini tidak pernah memberikan suaminya atau bahkan untuk kekasihnya, selama kehamilan atau menyusui, karena mereka mengatakan: "akan untuk fant saya di".
meskipun poligami secara hukum diperbolehkan dalam populasi Malaysia, hampir tidak diamalkan hanya oleh orang kaya, yang tidak banyak; Chris atau cultivateure kecil tidak mampu kemewahan makan lebih dari satu isteri; Ianya demikian pula Maporais.
jika gadis-gadis hilang di desanya, Maporais hampir tidak menemukan seorang sahabat, bukan hanya karena dia terlalu miskin untuk membayar mas kawin, melainkan justru karena ia membenci sebagai kafir, yang makan hewan yang najis. Oleh karena itu terpaksa Jika ia ingin menikah, untuk menghilangkan seorang wanita atau seorang gadis dari desa lain yang tidak tidak biasanya banyak konsekuensi bencana, karena Bankanais terlalu longgar, .venger baik kehormatan, baik untuk mempertahankan atau melanjutkan putrinya kepada penculiknya. Saya harus menambahkan bahwa wanita ini tidak jarang bahagia, dan bahwa mereka tidak menuntut terlalu banyak terhadap kekerasan yang mereka harus menjalani.
perbudakan dihapuskan di Hindia Belanda, sejak tanggal 1 Januari 1860, karena ada lebih banyak budak Banka. Laporan Maporais dengan wakil-wakil pemerintah adalah yang termudah; mereka melakukan pekerjaan; bahwa mereka diperintahkan untuk melakukan, dan membayar pajak, sedemikian rupa bahwa mereka akan pernah menimbulkan keluhan serius. Sebagai jumlah mereka tidak melebihi beberapa ratus, mereka tahu nama-nama mereka, dan karena itu perlu (totem), atau tanda-tanda pengenalan. Mereka memiliki tidak industri lainnya yang berburu, Memancing dan budidaya ladangs. Hal ini digunakan, sebagian besar waktu, sebagai pembawa tandu.
oleh ladang,. berarti bebas irigasi sawah yang bergantung pada uniquemeut hujan. Untuk mendirikan ladangs, sikat pemotong dan pohon-pohon yang tidak terlalu besar tingkat yang diinginkan; diperbolehkan untuk kering, potong kayu untuk beberapa bulan kemudian, setelah ada dipecat beberapa hari sebelum hujan pertama, yang ditaburkan adalah beras dalam lescendres didinginkan. Jika hujan datang, dan itu menyenangkan Allah, kita akan memiliki hasil panen yang berlimpah dari beras yang. ini tidak begitu selera, tapi jauh lebih bergizi daripada yang dipanen di nasi irrigable (sawa). Kerugian dari budaya ini adalah, selain penibletravail memotong kayu, penghancuran tercela sering sejumlah besar hutan untuk mengumpulkan, Singkatnya, yang beberapa kantong beras. Akibatnya, negara ini di boise, dan hujan menjadi jarang dan kurang. abonndantes
pemerintah telah mencoba untuk memperkenalkan budaya, sawa Banka; tetapi itu kesalahan tidak membela pembentukan ladangs sekali dan untuk semua, yang secara alami akan biaya uang, karena ia akan harus mengimpor beras dan menyediakannya dengan harga di bawah harga, setidaknya tiga tahun. Pada kenyataannya, hewan-domestik, Maporais memiliki beberapa ekor ayam, dan kadang-kadang anjing. Untuk Memancing, mereka menggunakan garis dan jaring rajutan sendiri. Berburu babi hutan yang dibuat melalui parit cache dan ditutupi ringan, di mana adalah ditempatkan umpan apapun. Rusa terperangkap dalam jaring yang besar di
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
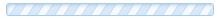
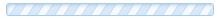
J'ignore absolument si l'on s'est occupé des Maporais, n'ayant jamais trouvé leur nom dans aucune relation de voyage ni autre livre. On aura probablement pensé qu'ils n'en valaient pas la peine.Mapor est uns kampong (village) situé sur la frontière septentrionale du district de Soengeiliat, avec celui de Blinjoe; dans l'île de Banka.
Les habitants de ce kampong ne seraient pas originaires de l'île; mais, d'après une vieille légende, représenteraient les- descendants de l'équipage d'une jonque cochinchinoise, qui a péri sur la côte de Banka, à l'embouchure du Soengei-Mapor (rivière de Mapor). On n'a aucune donnée sur l'époque de l'arrivée de cette jonque. L'équipage, n'ayant pas les moyens de retourner dans son pays, se serait fixé près de la côte, dans le kampong de Mapor; cependant, il n'est pas dit s'ils ont fondé ce kampong ou non, et, en s'unissant à des femmes du pays, s'ils ont donné naissance à la tribu des Ma
Ce n'est qu'après l'émeute d'Amir, en 1850, qu'on a force la population de quitter ses ladangs et de se réunir dans des kampongs, le long des grandes routes. J'ignore si Mapor a été dans le même cas ou non.La raison pour laquelle les Bankanais préféraient vivre surleurs ladangs, au lieu de se réunir en communauté, était, outre la commodité qu'ils trouvaient d'habiter là où ils cultivaient leur riz en satisfaisant ainsi à i leur paresse innée, la écumeurs de mer venait, de l'archipel de Solo et de Mindanao, dans l'île de Banka, pour enlever un plus ou moins grand nombre de personnes, surtout des femmes et des filles, qu'ils réduisaient en esclavage. Il est clair que, dans les bois, la population était plus à l'abri de ces invasions que dans les villages, étant donné que le Bankanais n'a pas le courage de défendre ni son bien, ni sa personne, contre les attaques de qui que ce soit.
Les Maporais ne ressemblent pas beaucoup aux Bankanais; ils sont plus grands, d'une constitution plus forte, plus éner giques, et, signe distinctif, bien plus braves. Le Bankanais pur sang se nourrit exclusivement de riz, noir ou rouge, de grain et de poisson; il ne mange que bien rarement de la viande, parce qu'il n'y a pas de bêtes domestiques autres que les porcs des Chinois, auxquels sa religion lui défend de toucher; ce n'est que 'quand il parvient à prendre un cerf ou un daim, dans ses filets, qu'il peut sepermettre le luxe de manger un morceau de viands. Le Maporais, au contraire, mange tout ce qu'il peut se procurer : du sanglier, du serpent, des grenouilles, du crocodile. Il cuit ou rôtit sa viande ou son poisson, comme les autres indigènes, et en mange autant qu'il peut. Comme tous les habitants de l'archipel malais, il est d'une grande imprévoyance, et ne fera jamais de provisions (excepté le riz qu'il cultive) ; la mer et la forêt lui fourniront, d'ailleurs, toujours du poisson et du gibier en abondance.
porais actuels. La supposition d'après laquelle ils se seraient fixés dans le kampong de Mapor. n'est peut-être pas tout à fait exacte, car autrefois il n'y avait pas de village, à proprement dire, dans l'île de Banka; chaque famille allait demeurer dans les bois, sur son ladang (rizière non irriguée), et changeait tous les deux ou trois ans de domicile, de telle sorte qu'on ne savait jamais trouver les personnes dont on pouvait avoir besoin.
Les substances enivrantes et excitantes ne leur sont guère connues, à l'exception du tabac, qu'ils fument en cigarettes ou dans des pipes en bois (bambou) ou en métal ; ces der nières sont de fabrication chinoise.
L'opium, cette immense plaie des Orientaux, est trop cherpour la pauvre population de Banka,et surtout pour le Maporais. Le Maporais est beaucoup moins sensible à la douleur physique que les autres indigènes de l'île. Je ne saurais dire si les autres sens sont plus ou moins développés, parce qu'il est très difficile d'entrer en communication d'idée avec eux ; ils sont si peu développés qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Ils diffèrent, en tout cas, beaucoup des peuples plus civilisés, sous le rapport de la sensibilité olfactive, car ils supportent les odeurs les plus nauséabondes avec la plus grande placidité.
Ils ne portent ordinairement aucune espèce de parure, ni même de vêtements, à l'exception d'un petit morceau de cotonnade, ou même d'écorce d'arbre, en forme de tablier, pour couvrir. les parties sexuelles. Ce tablier est un peu plus grand chez les femmes que chez les hommes, sans pour cela cacher beaucoup leur nudité. J'ai cependant vu quelques femmes avec des boucles d'oreille, et des enfants avec uncollier en grossières perles de verre ou de coquillages. Letatouage n'existe pas parmi eux.
Ils n'ont besoin d'aucune déformation ni mutilation pour être laids. Le beau sexe surtout est bien vilain. Ni danse, ni instrument de musique, ne sont en usage parmi eux; ils ont cependant une espèce de chant monotone et peu agréable à l'oreille, qui les aide à marcher en cadence, lorsqu'ils portent des fardeaux à plusieurs. Comme les autres indigènes de l'archipel, ils aiment leurs enfants et ne les maltraitent pas trop, ni leurs femmes non plus, sans avoir pour cela une trop grande tendresse pour elles. Ils ont le respect des vieillards. Ce sont surtout les femmes qui portent les charges les plus lourdes ; elles sont, en général, très recherchées comme porteuses de palanquin, parce qu'elles ont la marche sûre et légère, et qu'elles sont réellement infatigables.
Si les Maporais ont un culte quelconque, il doit être des plus primitifs, car on ne s'en aperçoit pas du tout. Seuls des indigènes de Banka, ils ne sont pas musulmans et mangent du porc ; c'est pour cette raison qu'ils sont généralement
méprisés. J'ignore s'ils font des sacrifices ou des offrandes, mais je ne le crois pas. Ils enterrent leurs morts sans grandes cérémonies. Je ne suis pas bien certain qu'ils croient à une vie future, mais ils ont une certaine idée d'un génie bienfaisant ou malfaisant, selon les circonstances. On ne peut pas dire qu'ils sont indifférents en matière religieuse, je crois plutôt qu'ils n'y pensent pas du tout, car ils n'ont ni prêtre, ni culte, ni temple, ni prière. Ils vivent assez bien en famille, et s'occupent de leurs enfants pour les nourrir. L'héritage n'existe pas, parce qu'ils ne possèdent rien.
Les passions contre nature sont généralement peu connues des indigènes de l'archipel malais. Quoique cela n'ait aucun rapport directs avec- les Maporais, il est à remarquer qu'en général les femmes malaises et javanaises ont un sentiment de pudeur, je dirais plutôt de convenance hygiénique, qu'on ne rencontre que rarement chez les femmes européennes; ainsi, aucune de ces femmes ne se donnera jamais ni à son mari, ni même à son amant, pendant la gestation ou l'allaitement, parce qu'elles disent : “Cela nuirait à mon en fant”.
Quoique la polygamie soit légalement permise à la population de la Malaisie, elle n'est guère pratiquée que par les riches, qui ne sont pas nombreux; le couli ou le petit cultivateure ne peut pas se permettre le luxe de nourrir plus d'une femme; il en est de même des Maporais.
Si les filles à marier manquent dans son village, le Maporais trouve difficilement une compagne, non seulement parce qu'il est trop pauvre pour payer une dot, mais plutôt parce qu'il est méprisé comme kafir, qui mange des bêtes impures. Il est donc bien forcé, s'il veut se marier, d'enlever une femme ou une fille d'un autre village, ce qui n'entraîne ordinairement pas des conséquences bien funestes, parce que le Bankanais est trop lâche, soit pour .venger son honneur, soit pour défendre ou reprendre sa fille à son ravisseur. Je dois ajouter que ces femmes se trouvent rarement malheureuses, et qu'elles ne réclament pas trop contre la violence qu'elles ont eu à subir.
L'esclavage étant aboli aux Indes néerlandaises, depuis le 1er janvier 1860, il n'y a donc plus d'esclaves à Banka. Les rapports des Maporais avec les représentants du gouvernement sont des plus faciles ; ils exécutent les travaux; qu'on leur ordonne de faire, et payent les impositions, de manière qu'ils ne donnent jamais lieu à des plaintes sérieuses. Comme leur nombre ne dépasse pas quelques centaines, ils se connaissent tous par leurs noms, et n'ont donc besoin ni d'un (totem ), ni de signe de reconnaissance. Ils n'ont pas d'autre industrie que la chasse, la pêche et la culture des ladangs. Il servent, la plupart du temps, comme porteurs de palanquin.
Par ladang, on entend les rizières non irrigables qui dépendent uniquemeut de la pluie. Pour établir les ladangs, on coupe les broussailles et les arbres qui ne sont pas trop gros sur une étendue voulue; on laisse sécher, ce bois coupé pendant quelques mois, puis, après y avoir mis le feu quelques jours avant les premières pluies, on sème le riz dans lescendres refroidies. Si la pluie vient, et qu'il plaise à Allah, on aura une abondante moisson d'un riz qui. n'est pas si appétissant, mais bien plus nutritif, que celui que l'on récolte dans les rizières irrigables (sawa). L'inconvénient de cette culture est, outre le pénibletravail de couper le bois, une destruction déplorable souvent de grandes étendues de bois précieux pour ne récolter, en somme, que, quelques sacs de riz. Par suite, le pays se dé boise, et les pluies deviennent plus rares et moins abonndantes.
Le gouvernement a déjà essayé d'introduire la culture des, sawa à Banka; mais on a commis la faute de ne pas defendre l'établissement des ladangs une fois pour toutes, ce qui aurait naturellement coûté de l'argent, parce qu'il aurait fallu importer du riz et le fournir à un prix au-dessous du prix de revient, pendant au moins trois ans. En fait, d'animaux- domestiques, le Maporais a quelques poules, et quelquefois un chien. Pour la pêche, ils se servent de la ligne et d'un filet tricoté par eux-mêmes. La chasse au sanglier est faite au moyen de fosses caches et recouvertes légèrement, dans lesquelles on place un appât quelconque. Les cerfs sont pris dans de grands filets en
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
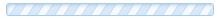
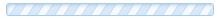
Bahasa lainnya
Dukungan alat penerjemahan: Afrikans, Albania, Amhara, Arab, Armenia, Azerbaijan, Bahasa Indonesia, Basque, Belanda, Belarussia, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Burma, Cebuano, Ceko, Chichewa, China, Cina Tradisional, Denmark, Deteksi bahasa, Esperanto, Estonia, Farsi, Finlandia, Frisia, Gaelig, Gaelik Skotlandia, Galisia, Georgia, Gujarati, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Ibrani, Igbo, Inggris, Islan, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Kannada, Katala, Kazak, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Klingon, Korea, Korsika, Kreol Haiti, Kroat, Kurdi, Laos, Latin, Latvia, Lituania, Luksemburg, Magyar, Makedonia, Malagasi, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Melayu, Mongol, Nepal, Norsk, Odia (Oriya), Pashto, Polandia, Portugis, Prancis, Punjabi, Rumania, Rusia, Samoa, Serb, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovakia, Slovenia, Somali, Spanyol, Sunda, Swahili, Swensk, Tagalog, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turki, Turkmen, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnam, Wales, Xhosa, Yiddi, Yoruba, Yunani, Zulu, Bahasa terjemahan.
- 1maret..awal sesuatu yang baru
- menikah
- 1 Maret..awal sesuatu yang baru
- voce tem quantos anos
- Gonna get cought
- ninguem
- 1 Maret..Harus menjadi awal sesuatu yang
- quero casar agora nao
- 1 Maret..awal buat status bahasa inggris
- umur kita cocok
- 1 Maret....harus menjadi awal sesuatu ya
- apakah hari ini kamu mau jadi pacar aku
- 1 Maret....harus menjadi awal sesuatu ya
- Leggete: http://passioneinter.net/?p=629
- You make me happy
- Diam tanpa kata
- Embankment in swamps or water shall be c
- бро
- Ohh isma..Cepot tidak kuasa melupakanmuC
- Gadis yang sangat manis
- If unsuitable materials occur in some ar
- Little
- sukses buat ujian kamu hari ini adikku
- Unless otherwise shown on the Outline De

