- Teks
- Sejarah
Le lien entre besoins et publics Si
Le lien entre besoins et publics
Si l’analyse des besoins est novatrice dans les années 70, c’est d’une part que pour la première fois, il y a volonté de différencier les enseignements en tenant compte de la variété des publics et en leur fournissant des conditions adaptées, et d’autre part, qu’il y a création de techniques d’analyse propres à cette démarche et permettant de caractériser les différences entre publics.
Ces techniques d’analyse consistent concrètement en un recueil de données au moyen de questionnaires, d’entretiens ou d’interviews. Les questions abordées comprennent des informations sur l’identité des apprenants, leur « biographie linguistique » (langues parlées, apprises, habitudes linguistiques…), leurs raisons d’apprendre, les représentations qu’ils se font de l’utilisation future de la langue et leurs attitudes par rapport à cette langue et éventuellement d’autres. Pour des exemples concrets voir le chapitre 2 de Mangiante et Parpette (2004).
Mangiante et Parpette (2004 : 22-23) soulignent par ailleurs que c’est seulement lorsque le public est connu que l’on peut en analyser les besoins, et partant, prévoir des objectifs adaptés à ce public particulier, et évolutifs au cours de la formation. En revanche, une logique de l’offre qui ne peut pas s’appuyer sur une analyse de besoins ne pourra se fixer des objectifs qu’en termes de spécificités linguistique du domaine envisagé, d’où une approche du type « français de spécialité ».
Critique de la notion de besoins langagiers
Les 4 premières sont répertoriées par Richterich lui-même (1985 : 27-28) :
- Les « besoins langagiers » n’existent pas réellement comme objets du monde, ce sont des constructions conceptuelles. Par conséquent, on ne peut pas réellement en dresser un inventaire ou les décrire, on peut au mieux les identifier, c'est-à-dire les construire abstraitement par un processus d’identification (donner une identité).
- Bien souvent, l’identification des besoins langagiers donne l’illusion aux apprenants qu’ils sont pris en compte en tant qu’individus dans la prise de décision, alors qu’en réalité, leur ignorance de beaucoup de facteurs (utilisation future de la langue, conditions d’enseignement et d’apprentissage) est un prétexte à ce que l’institution leur impose ses choix.
- L’identification des besoins se doit d’être continue tout au long de l’enseignement/apprentissage, de manière à tenir compte du fait que les apprenants se créent des besoins en apprenant, et que l’enseignant qui ignore parfois tout du domaine d’application se familiarise avec lui en fréquentant les apprenants. Or, l’identification des besoins a souvent été conçue dans des systèmes linéaires (voir critique dans Lehmann 1983 des enchaînements mécaniques entre les phases successives des systèmes de conception d’enseignements de FOS) qui n’admettent pas de retour aux étapes antérieures.
- L’expérience a montré que nombre d’enquêtes et d’analyses des besoins n’ont pas abouti à de quelconques applications pédagogiques, le poids des institutions et des systèmes de formation et l’inertie des individus étant souvent trop grands. De ce fait, les grandes enquêtes ont été abandonnées au bénéfice de pratiques plus légères, qu’on s’efforce d’intégrer au mieux aux processus d’enseignement/apprentissage.
D. Lehmann (1983 et 1990 : 84-85) y ajoute :
- les analyses de besoins ont le plus souvent pour effet de traduire les besoins en objectifs de type linguistiques : « réalités langagières que les apprenants sont censés acquérir et maîtriser » dans des « situations cibles ». Or, cette vision met totalement de côté ce que Lehmann appelle les « besoins d’apprentissage », pas uniquement linguistiques mais aussi socioculturels et psycho-affectifs.
- il existe des limites « idéologiques » à ces approches, qui sont les « tensions réelles entre besoins des apprenants et besoins des institutions » menant d’un extrême « technocratique » à un autre extrême « spontanéiste ».
Des amorces de solution
Après avoir fait le constat que ces analyses, malgré leur difficulté, restent indispensables, D. Lehmann (1990 : 85-87) recense deux grandes catégories de propositions d’amélioration :
- Celles qui visent à une simplification de l’appareil analytique et de la procédure. Richterich lui-même évolue dans ce sens entre ses différentes publications (1973, 1977, 1985), abandonnant une analyse systémique encore très marquée par la structuralisme (inventaire minutieux de situations d’apprentissage, de situations de communication et leur décomposition en une foule d’actes et de sous-actes) au profit d’une approche plus basée sur les principes de la démarche que sur des procédures : « distinction entre besoins et ressources, non-coïncidence entre les besoins des divers partenaires (apprenants, institution, société), nécessité de ménager un compromis entre les uns et les autres, rôle de la négociation avec le groupe d’apprenants en vue de parvenir à ce compromis ».
- Celles qui visent à introduire dans l’analyse les composantes autres que langagières et les situations cibles, nommément les situations d’apprentissage. « Ceci implique d’abord la prise en compte des particularismes de la situation d’apprentissage ainsi que de ceux des apprenants, qu’il s’agisse aussi bien de leurs spécificités socioculturelles que de leurs habitudes d’apprentissage et de leurs représentations linguistiques ». C’est la « centration sur l’apprentissage » par la prise en compte prioritaire des besoins d’apprentissage. Et citant Hutchinson et Waters (1987) :
« Nous devons regarder au-delà de la compétence qui permet à quelqu’un de communiquer, car ce que nous voulons véritablement découvrir ce n’est pas la compétence elle-même, mais comment on peut l’acquérir ».
Lehmann (1993 : 131-139) élabore cette notion de « besoins d’apprentissage » de manière à y inclure tous les besoins des apprenants au moment de l’E/A, et non seulement leur supposés besoin futurs, une fois l’apprentissage terminé. Il distingue deux types de besoins (les besoins dépendants et les besoins non-dépendants, op. cit. : p. 133-134), eux-mêmes composés de trois composantes :
- une composante psycho-affective, qui prend en compte le sentiment d’insécurité lié à toute situation d’apprentissage, sentiment qui peut être renforcé chez les adultes professionnels par l’idée que l’apprentissage est infantilisant ;
- une composante langagière, qui se décompose en trois domaines distincts : besoins liés à la communication dans la classe ; besoins liés à « la prise de conscience du fossé qui existe entre la classe et la communication réelle » ; enfin « un type de besoins lié en propre à l’apprentissage et dont on pourrait dire qu’il est le besoin de prendre la mesure de ce qui se joue dans l’apprentissage d’une langue » et qui touche aux représentations de l’apprenant sur le langage (cf. l’anglais « language awareness ») ;
- une composante socio-culturelle, qui doit englober une part de « la compétence particulière requise par la communication spécialisée », sans pour autant prétendre s’y substituer ou la reproduire totalement (il y a en effet des limites à « l’authenticité » dans les situations de classe).
Enfin, une autre voie possible est de s’extraire totalement de l’analyse des besoins, conformément à la proposition de Louis Porcher, pour qui il convient de
« sortir complètement de la problématique d’identification des besoins, qui se marque par une attention portée à la demande, pour se situer dans la problématique qui lui est symétrique, celle de l’offre de formation. Ceci ne veut évidemment pas dire que les besoins d’apprentissage n’existent pas, mais qu’il incombe à l’apprenant de gérer lui-même ses propres besoins au sein d’une relation entre l’offre et la demande qui a donc toutes les apparences d’un marché ».
Si l’analyse des besoins est novatrice dans les années 70, c’est d’une part que pour la première fois, il y a volonté de différencier les enseignements en tenant compte de la variété des publics et en leur fournissant des conditions adaptées, et d’autre part, qu’il y a création de techniques d’analyse propres à cette démarche et permettant de caractériser les différences entre publics.
Ces techniques d’analyse consistent concrètement en un recueil de données au moyen de questionnaires, d’entretiens ou d’interviews. Les questions abordées comprennent des informations sur l’identité des apprenants, leur « biographie linguistique » (langues parlées, apprises, habitudes linguistiques…), leurs raisons d’apprendre, les représentations qu’ils se font de l’utilisation future de la langue et leurs attitudes par rapport à cette langue et éventuellement d’autres. Pour des exemples concrets voir le chapitre 2 de Mangiante et Parpette (2004).
Mangiante et Parpette (2004 : 22-23) soulignent par ailleurs que c’est seulement lorsque le public est connu que l’on peut en analyser les besoins, et partant, prévoir des objectifs adaptés à ce public particulier, et évolutifs au cours de la formation. En revanche, une logique de l’offre qui ne peut pas s’appuyer sur une analyse de besoins ne pourra se fixer des objectifs qu’en termes de spécificités linguistique du domaine envisagé, d’où une approche du type « français de spécialité ».
Critique de la notion de besoins langagiers
Les 4 premières sont répertoriées par Richterich lui-même (1985 : 27-28) :
- Les « besoins langagiers » n’existent pas réellement comme objets du monde, ce sont des constructions conceptuelles. Par conséquent, on ne peut pas réellement en dresser un inventaire ou les décrire, on peut au mieux les identifier, c'est-à-dire les construire abstraitement par un processus d’identification (donner une identité).
- Bien souvent, l’identification des besoins langagiers donne l’illusion aux apprenants qu’ils sont pris en compte en tant qu’individus dans la prise de décision, alors qu’en réalité, leur ignorance de beaucoup de facteurs (utilisation future de la langue, conditions d’enseignement et d’apprentissage) est un prétexte à ce que l’institution leur impose ses choix.
- L’identification des besoins se doit d’être continue tout au long de l’enseignement/apprentissage, de manière à tenir compte du fait que les apprenants se créent des besoins en apprenant, et que l’enseignant qui ignore parfois tout du domaine d’application se familiarise avec lui en fréquentant les apprenants. Or, l’identification des besoins a souvent été conçue dans des systèmes linéaires (voir critique dans Lehmann 1983 des enchaînements mécaniques entre les phases successives des systèmes de conception d’enseignements de FOS) qui n’admettent pas de retour aux étapes antérieures.
- L’expérience a montré que nombre d’enquêtes et d’analyses des besoins n’ont pas abouti à de quelconques applications pédagogiques, le poids des institutions et des systèmes de formation et l’inertie des individus étant souvent trop grands. De ce fait, les grandes enquêtes ont été abandonnées au bénéfice de pratiques plus légères, qu’on s’efforce d’intégrer au mieux aux processus d’enseignement/apprentissage.
D. Lehmann (1983 et 1990 : 84-85) y ajoute :
- les analyses de besoins ont le plus souvent pour effet de traduire les besoins en objectifs de type linguistiques : « réalités langagières que les apprenants sont censés acquérir et maîtriser » dans des « situations cibles ». Or, cette vision met totalement de côté ce que Lehmann appelle les « besoins d’apprentissage », pas uniquement linguistiques mais aussi socioculturels et psycho-affectifs.
- il existe des limites « idéologiques » à ces approches, qui sont les « tensions réelles entre besoins des apprenants et besoins des institutions » menant d’un extrême « technocratique » à un autre extrême « spontanéiste ».
Des amorces de solution
Après avoir fait le constat que ces analyses, malgré leur difficulté, restent indispensables, D. Lehmann (1990 : 85-87) recense deux grandes catégories de propositions d’amélioration :
- Celles qui visent à une simplification de l’appareil analytique et de la procédure. Richterich lui-même évolue dans ce sens entre ses différentes publications (1973, 1977, 1985), abandonnant une analyse systémique encore très marquée par la structuralisme (inventaire minutieux de situations d’apprentissage, de situations de communication et leur décomposition en une foule d’actes et de sous-actes) au profit d’une approche plus basée sur les principes de la démarche que sur des procédures : « distinction entre besoins et ressources, non-coïncidence entre les besoins des divers partenaires (apprenants, institution, société), nécessité de ménager un compromis entre les uns et les autres, rôle de la négociation avec le groupe d’apprenants en vue de parvenir à ce compromis ».
- Celles qui visent à introduire dans l’analyse les composantes autres que langagières et les situations cibles, nommément les situations d’apprentissage. « Ceci implique d’abord la prise en compte des particularismes de la situation d’apprentissage ainsi que de ceux des apprenants, qu’il s’agisse aussi bien de leurs spécificités socioculturelles que de leurs habitudes d’apprentissage et de leurs représentations linguistiques ». C’est la « centration sur l’apprentissage » par la prise en compte prioritaire des besoins d’apprentissage. Et citant Hutchinson et Waters (1987) :
« Nous devons regarder au-delà de la compétence qui permet à quelqu’un de communiquer, car ce que nous voulons véritablement découvrir ce n’est pas la compétence elle-même, mais comment on peut l’acquérir ».
Lehmann (1993 : 131-139) élabore cette notion de « besoins d’apprentissage » de manière à y inclure tous les besoins des apprenants au moment de l’E/A, et non seulement leur supposés besoin futurs, une fois l’apprentissage terminé. Il distingue deux types de besoins (les besoins dépendants et les besoins non-dépendants, op. cit. : p. 133-134), eux-mêmes composés de trois composantes :
- une composante psycho-affective, qui prend en compte le sentiment d’insécurité lié à toute situation d’apprentissage, sentiment qui peut être renforcé chez les adultes professionnels par l’idée que l’apprentissage est infantilisant ;
- une composante langagière, qui se décompose en trois domaines distincts : besoins liés à la communication dans la classe ; besoins liés à « la prise de conscience du fossé qui existe entre la classe et la communication réelle » ; enfin « un type de besoins lié en propre à l’apprentissage et dont on pourrait dire qu’il est le besoin de prendre la mesure de ce qui se joue dans l’apprentissage d’une langue » et qui touche aux représentations de l’apprenant sur le langage (cf. l’anglais « language awareness ») ;
- une composante socio-culturelle, qui doit englober une part de « la compétence particulière requise par la communication spécialisée », sans pour autant prétendre s’y substituer ou la reproduire totalement (il y a en effet des limites à « l’authenticité » dans les situations de classe).
Enfin, une autre voie possible est de s’extraire totalement de l’analyse des besoins, conformément à la proposition de Louis Porcher, pour qui il convient de
« sortir complètement de la problématique d’identification des besoins, qui se marque par une attention portée à la demande, pour se situer dans la problématique qui lui est symétrique, celle de l’offre de formation. Ceci ne veut évidemment pas dire que les besoins d’apprentissage n’existent pas, mais qu’il incombe à l’apprenant de gérer lui-même ses propres besoins au sein d’une relation entre l’offre et la demande qui a donc toutes les apparences d’un marché ».
0/5000
Le lien entre besoins et publics Si l’analyse des besoins est novatrice dans les années 70, c’est d’une part que pour la première fois, il y a volonté de différencier les enseignements en tenant compte de la variété des publics et en leur fournissant des conditions adaptées, et d’autre part, qu’il y a création de techniques d’analyse propres à cette démarche et permettant de caractériser les différences entre publics. Ces techniques d’analyse consistent concrètement en un recueil de données au moyen de questionnaires, d’entretiens ou d’interviews. Les questions abordées comprennent des informations sur l’identité des apprenants, leur « biographie linguistique » (langues parlées, apprises, habitudes linguistiques…), leurs raisons d’apprendre, les représentations qu’ils se font de l’utilisation future de la langue et leurs attitudes par rapport à cette langue et éventuellement d’autres. Pour des exemples concrets voir le chapitre 2 de Mangiante et Parpette (2004). Mangiante et Parpette (2004 : 22-23) soulignent par ailleurs que c’est seulement lorsque le public est connu que l’on peut en analyser les besoins, et partant, prévoir des objectifs adaptés à ce public particulier, et évolutifs au cours de la formation. En revanche, une logique de l’offre qui ne peut pas s’appuyer sur une analyse de besoins ne pourra se fixer des objectifs qu’en termes de spécificités linguistique du domaine envisagé, d’où une approche du type « français de spécialité ». Critique de la notion de besoins langagiers Les 4 premières sont répertoriées par Richterich lui-même (1985 : 27-28) : - Les « besoins langagiers » n’existent pas réellement comme objets du monde, ce sont des constructions conceptuelles. Par conséquent, on ne peut pas réellement en dresser un inventaire ou les décrire, on peut au mieux les identifier, c'est-à-dire les construire abstraitement par un processus d’identification (donner une identité). - Bien souvent, l’identification des besoins langagiers donne l’illusion aux apprenants qu’ils sont pris en compte en tant qu’individus dans la prise de décision, alors qu’en réalité, leur ignorance de beaucoup de facteurs (utilisation future de la langue, conditions d’enseignement et d’apprentissage) est un prétexte à ce que l’institution leur impose ses choix. - L’identification des besoins se doit d’être continue tout au long de l’enseignement/apprentissage, de manière à tenir compte du fait que les apprenants se créent des besoins en apprenant, et que l’enseignant qui ignore parfois tout du domaine d’application se familiarise avec lui en fréquentant les apprenants. Or, l’identification des besoins a souvent été conçue dans des systèmes linéaires (voir critique dans Lehmann 1983 des enchaînements mécaniques entre les phases successives des systèmes de conception d’enseignements de FOS) qui n’admettent pas de retour aux étapes antérieures. - L’expérience a montré que nombre d’enquêtes et d’analyses des besoins n’ont pas abouti à de quelconques applications pédagogiques, le poids des institutions et des systèmes de formation et l’inertie des individus étant souvent trop grands. De ce fait, les grandes enquêtes ont été abandonnées au bénéfice de pratiques plus légères, qu’on s’efforce d’intégrer au mieux aux processus d’enseignement/apprentissage. D. Lehmann (1983 et 1990 : 84-85) y ajoute : - les analyses de besoins ont le plus souvent pour effet de traduire les besoins en objectifs de type linguistiques : « réalités langagières que les apprenants sont censés acquérir et maîtriser » dans des « situations cibles ». Or, cette vision met totalement de côté ce que Lehmann appelle les « besoins d’apprentissage », pas uniquement linguistiques mais aussi socioculturels et psycho-affectifs. - il existe des limites « idéologiques » à ces approches, qui sont les « tensions réelles entre besoins des apprenants et besoins des institutions » menant d’un extrême « technocratique » à un autre extrême « spontanéiste ». Des amorces de solution Après avoir fait le constat que ces analyses, malgré leur difficulté, restent indispensables, D. Lehmann (1990 : 85-87) recense deux grandes catégories de propositions d’amélioration : - Celles qui visent à une simplification de l’appareil analytique et de la procédure. Richterich lui-même évolue dans ce sens entre ses différentes publications (1973, 1977, 1985), abandonnant une analyse systémique encore très marquée par la structuralisme (inventaire minutieux de situations d’apprentissage, de situations de communication et leur décomposition en une foule d’actes et de sous-actes) au profit d’une approche plus basée sur les principes de la démarche que sur des procédures : « distinction entre besoins et ressources, non-coïncidence entre les besoins des divers partenaires (apprenants, institution, société), nécessité de ménager un compromis entre les uns et les autres, rôle de la négociation avec le groupe d’apprenants en vue de parvenir à ce compromis ». - Celles qui visent à introduire dans l’analyse les composantes autres que langagières et les situations cibles, nommément les situations d’apprentissage. « Ceci implique d’abord la prise en compte des particularismes de la situation d’apprentissage ainsi que de ceux des apprenants, qu’il s’agisse aussi bien de leurs spécificités socioculturelles que de leurs habitudes d’apprentissage et de leurs représentations linguistiques ». C’est la « centration sur l’apprentissage » par la prise en compte prioritaire des besoins d’apprentissage. Et citant Hutchinson et Waters (1987) : « Nous devons regarder au-delà de la compétence qui permet à quelqu’un de communiquer, car ce que nous voulons véritablement découvrir ce n’est pas la compétence elle-même, mais comment on peut l’acquérir ». Lehmann (1993 : 131-139) élabore cette notion de « besoins d’apprentissage » de manière à y inclure tous les besoins des apprenants au moment de l’E/A, et non seulement leur supposés besoin futurs, une fois l’apprentissage terminé. Il distingue deux types de besoins (les besoins dépendants et les besoins non-dépendants, op. cit. : p. 133-134), eux-mêmes composés de trois composantes : - une composante psycho-affective, qui prend en compte le sentiment d’insécurité lié à toute situation d’apprentissage, sentiment qui peut être renforcé chez les adultes professionnels par l’idée que l’apprentissage est infantilisant ; - une composante langagière, qui se décompose en trois domaines distincts : besoins liés à la communication dans la classe ; besoins liés à « la prise de conscience du fossé qui existe entre la classe et la communication réelle » ; enfin « un type de besoins lié en propre à l’apprentissage et dont on pourrait dire qu’il est le besoin de prendre la mesure de ce qui se joue dans l’apprentissage d’une langue » et qui touche aux représentations de l’apprenant sur le langage (cf. l’anglais « language awareness ») ; - une composante socio-culturelle, qui doit englober une part de « la compétence particulière requise par la communication spécialisée », sans pour autant prétendre s’y substituer ou la reproduire totalement (il y a en effet des limites à « l’authenticité » dans les situations de classe). Enfin, une autre voie possible est de s’extraire totalement de l’analyse des besoins, conformément à la proposition de Louis Porcher, pour qui il convient de « sortir complètement de la problématique d’identification des besoins, qui se marque par une attention portée à la demande, pour se situer dans la problématique qui lui est symétrique, celle de l’offre de formation. Ceci ne veut évidemment pas dire que les besoins d’apprentissage n’existent pas, mais qu’il incombe à l’apprenant de gérer lui-même ses propres besoins au sein d’une relation entre l’offre et la demande qui a donc toutes les apparences d’un marché ».
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
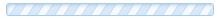
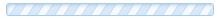
Le lien entre besoins et publics
Si l’analyse des besoins est novatrice dans les années 70, c’est d’une part que pour la première fois, il y a volonté de différencier les enseignements en tenant compte de la variété des publics et en leur fournissant des conditions adaptées, et d’autre part, qu’il y a création de techniques d’analyse propres à cette démarche et permettant de caractériser les différences entre publics.
Ces techniques d’analyse consistent concrètement en un recueil de données au moyen de questionnaires, d’entretiens ou d’interviews. Les questions abordées comprennent des informations sur l’identité des apprenants, leur « biographie linguistique » (langues parlées, apprises, habitudes linguistiques…), leurs raisons d’apprendre, les représentations qu’ils se font de l’utilisation future de la langue et leurs attitudes par rapport à cette langue et éventuellement d’autres. Pour des exemples concrets voir le chapitre 2 de Mangiante et Parpette (2004).
Mangiante et Parpette (2004 : 22-23) soulignent par ailleurs que c’est seulement lorsque le public est connu que l’on peut en analyser les besoins, et partant, prévoir des objectifs adaptés à ce public particulier, et évolutifs au cours de la formation. En revanche, une logique de l’offre qui ne peut pas s’appuyer sur une analyse de besoins ne pourra se fixer des objectifs qu’en termes de spécificités linguistique du domaine envisagé, d’où une approche du type « français de spécialité ».
Critique de la notion de besoins langagiers
Les 4 premières sont répertoriées par Richterich lui-même (1985 : 27-28) :
- Les « besoins langagiers » n’existent pas réellement comme objets du monde, ce sont des constructions conceptuelles. Par conséquent, on ne peut pas réellement en dresser un inventaire ou les décrire, on peut au mieux les identifier, c'est-à-dire les construire abstraitement par un processus d’identification (donner une identité).
- Bien souvent, l’identification des besoins langagiers donne l’illusion aux apprenants qu’ils sont pris en compte en tant qu’individus dans la prise de décision, alors qu’en réalité, leur ignorance de beaucoup de facteurs (utilisation future de la langue, conditions d’enseignement et d’apprentissage) est un prétexte à ce que l’institution leur impose ses choix.
- L’identification des besoins se doit d’être continue tout au long de l’enseignement/apprentissage, de manière à tenir compte du fait que les apprenants se créent des besoins en apprenant, et que l’enseignant qui ignore parfois tout du domaine d’application se familiarise avec lui en fréquentant les apprenants. Or, l’identification des besoins a souvent été conçue dans des systèmes linéaires (voir critique dans Lehmann 1983 des enchaînements mécaniques entre les phases successives des systèmes de conception d’enseignements de FOS) qui n’admettent pas de retour aux étapes antérieures.
- L’expérience a montré que nombre d’enquêtes et d’analyses des besoins n’ont pas abouti à de quelconques applications pédagogiques, le poids des institutions et des systèmes de formation et l’inertie des individus étant souvent trop grands. De ce fait, les grandes enquêtes ont été abandonnées au bénéfice de pratiques plus légères, qu’on s’efforce d’intégrer au mieux aux processus d’enseignement/apprentissage.
D. Lehmann (1983 et 1990 : 84-85) y ajoute :
- les analyses de besoins ont le plus souvent pour effet de traduire les besoins en objectifs de type linguistiques : « réalités langagières que les apprenants sont censés acquérir et maîtriser » dans des « situations cibles ». Or, cette vision met totalement de côté ce que Lehmann appelle les « besoins d’apprentissage », pas uniquement linguistiques mais aussi socioculturels et psycho-affectifs.
- il existe des limites « idéologiques » à ces approches, qui sont les « tensions réelles entre besoins des apprenants et besoins des institutions » menant d’un extrême « technocratique » à un autre extrême « spontanéiste ».
Des amorces de solution
Après avoir fait le constat que ces analyses, malgré leur difficulté, restent indispensables, D. Lehmann (1990 : 85-87) recense deux grandes catégories de propositions d’amélioration :
- Celles qui visent à une simplification de l’appareil analytique et de la procédure. Richterich lui-même évolue dans ce sens entre ses différentes publications (1973, 1977, 1985), abandonnant une analyse systémique encore très marquée par la structuralisme (inventaire minutieux de situations d’apprentissage, de situations de communication et leur décomposition en une foule d’actes et de sous-actes) au profit d’une approche plus basée sur les principes de la démarche que sur des procédures : « distinction entre besoins et ressources, non-coïncidence entre les besoins des divers partenaires (apprenants, institution, société), nécessité de ménager un compromis entre les uns et les autres, rôle de la négociation avec le groupe d’apprenants en vue de parvenir à ce compromis ».
- Celles qui visent à introduire dans l’analyse les composantes autres que langagières et les situations cibles, nommément les situations d’apprentissage. « Ceci implique d’abord la prise en compte des particularismes de la situation d’apprentissage ainsi que de ceux des apprenants, qu’il s’agisse aussi bien de leurs spécificités socioculturelles que de leurs habitudes d’apprentissage et de leurs représentations linguistiques ». C’est la « centration sur l’apprentissage » par la prise en compte prioritaire des besoins d’apprentissage. Et citant Hutchinson et Waters (1987) :
« Nous devons regarder au-delà de la compétence qui permet à quelqu’un de communiquer, car ce que nous voulons véritablement découvrir ce n’est pas la compétence elle-même, mais comment on peut l’acquérir ».
Lehmann (1993 : 131-139) élabore cette notion de « besoins d’apprentissage » de manière à y inclure tous les besoins des apprenants au moment de l’E/A, et non seulement leur supposés besoin futurs, une fois l’apprentissage terminé. Il distingue deux types de besoins (les besoins dépendants et les besoins non-dépendants, op. cit. : p. 133-134), eux-mêmes composés de trois composantes :
- une composante psycho-affective, qui prend en compte le sentiment d’insécurité lié à toute situation d’apprentissage, sentiment qui peut être renforcé chez les adultes professionnels par l’idée que l’apprentissage est infantilisant ;
- une composante langagière, qui se décompose en trois domaines distincts : besoins liés à la communication dans la classe ; besoins liés à « la prise de conscience du fossé qui existe entre la classe et la communication réelle » ; enfin « un type de besoins lié en propre à l’apprentissage et dont on pourrait dire qu’il est le besoin de prendre la mesure de ce qui se joue dans l’apprentissage d’une langue » et qui touche aux représentations de l’apprenant sur le langage (cf. l’anglais « language awareness ») ;
- une composante socio-culturelle, qui doit englober une part de « la compétence particulière requise par la communication spécialisée », sans pour autant prétendre s’y substituer ou la reproduire totalement (il y a en effet des limites à « l’authenticité » dans les situations de classe).
Enfin, une autre voie possible est de s’extraire totalement de l’analyse des besoins, conformément à la proposition de Louis Porcher, pour qui il convient de
« sortir complètement de la problématique d’identification des besoins, qui se marque par une attention portée à la demande, pour se situer dans la problématique qui lui est symétrique, celle de l’offre de formation. Ceci ne veut évidemment pas dire que les besoins d’apprentissage n’existent pas, mais qu’il incombe à l’apprenant de gérer lui-même ses propres besoins au sein d’une relation entre l’offre et la demande qui a donc toutes les apparences d’un marché ».
Si l’analyse des besoins est novatrice dans les années 70, c’est d’une part que pour la première fois, il y a volonté de différencier les enseignements en tenant compte de la variété des publics et en leur fournissant des conditions adaptées, et d’autre part, qu’il y a création de techniques d’analyse propres à cette démarche et permettant de caractériser les différences entre publics.
Ces techniques d’analyse consistent concrètement en un recueil de données au moyen de questionnaires, d’entretiens ou d’interviews. Les questions abordées comprennent des informations sur l’identité des apprenants, leur « biographie linguistique » (langues parlées, apprises, habitudes linguistiques…), leurs raisons d’apprendre, les représentations qu’ils se font de l’utilisation future de la langue et leurs attitudes par rapport à cette langue et éventuellement d’autres. Pour des exemples concrets voir le chapitre 2 de Mangiante et Parpette (2004).
Mangiante et Parpette (2004 : 22-23) soulignent par ailleurs que c’est seulement lorsque le public est connu que l’on peut en analyser les besoins, et partant, prévoir des objectifs adaptés à ce public particulier, et évolutifs au cours de la formation. En revanche, une logique de l’offre qui ne peut pas s’appuyer sur une analyse de besoins ne pourra se fixer des objectifs qu’en termes de spécificités linguistique du domaine envisagé, d’où une approche du type « français de spécialité ».
Critique de la notion de besoins langagiers
Les 4 premières sont répertoriées par Richterich lui-même (1985 : 27-28) :
- Les « besoins langagiers » n’existent pas réellement comme objets du monde, ce sont des constructions conceptuelles. Par conséquent, on ne peut pas réellement en dresser un inventaire ou les décrire, on peut au mieux les identifier, c'est-à-dire les construire abstraitement par un processus d’identification (donner une identité).
- Bien souvent, l’identification des besoins langagiers donne l’illusion aux apprenants qu’ils sont pris en compte en tant qu’individus dans la prise de décision, alors qu’en réalité, leur ignorance de beaucoup de facteurs (utilisation future de la langue, conditions d’enseignement et d’apprentissage) est un prétexte à ce que l’institution leur impose ses choix.
- L’identification des besoins se doit d’être continue tout au long de l’enseignement/apprentissage, de manière à tenir compte du fait que les apprenants se créent des besoins en apprenant, et que l’enseignant qui ignore parfois tout du domaine d’application se familiarise avec lui en fréquentant les apprenants. Or, l’identification des besoins a souvent été conçue dans des systèmes linéaires (voir critique dans Lehmann 1983 des enchaînements mécaniques entre les phases successives des systèmes de conception d’enseignements de FOS) qui n’admettent pas de retour aux étapes antérieures.
- L’expérience a montré que nombre d’enquêtes et d’analyses des besoins n’ont pas abouti à de quelconques applications pédagogiques, le poids des institutions et des systèmes de formation et l’inertie des individus étant souvent trop grands. De ce fait, les grandes enquêtes ont été abandonnées au bénéfice de pratiques plus légères, qu’on s’efforce d’intégrer au mieux aux processus d’enseignement/apprentissage.
D. Lehmann (1983 et 1990 : 84-85) y ajoute :
- les analyses de besoins ont le plus souvent pour effet de traduire les besoins en objectifs de type linguistiques : « réalités langagières que les apprenants sont censés acquérir et maîtriser » dans des « situations cibles ». Or, cette vision met totalement de côté ce que Lehmann appelle les « besoins d’apprentissage », pas uniquement linguistiques mais aussi socioculturels et psycho-affectifs.
- il existe des limites « idéologiques » à ces approches, qui sont les « tensions réelles entre besoins des apprenants et besoins des institutions » menant d’un extrême « technocratique » à un autre extrême « spontanéiste ».
Des amorces de solution
Après avoir fait le constat que ces analyses, malgré leur difficulté, restent indispensables, D. Lehmann (1990 : 85-87) recense deux grandes catégories de propositions d’amélioration :
- Celles qui visent à une simplification de l’appareil analytique et de la procédure. Richterich lui-même évolue dans ce sens entre ses différentes publications (1973, 1977, 1985), abandonnant une analyse systémique encore très marquée par la structuralisme (inventaire minutieux de situations d’apprentissage, de situations de communication et leur décomposition en une foule d’actes et de sous-actes) au profit d’une approche plus basée sur les principes de la démarche que sur des procédures : « distinction entre besoins et ressources, non-coïncidence entre les besoins des divers partenaires (apprenants, institution, société), nécessité de ménager un compromis entre les uns et les autres, rôle de la négociation avec le groupe d’apprenants en vue de parvenir à ce compromis ».
- Celles qui visent à introduire dans l’analyse les composantes autres que langagières et les situations cibles, nommément les situations d’apprentissage. « Ceci implique d’abord la prise en compte des particularismes de la situation d’apprentissage ainsi que de ceux des apprenants, qu’il s’agisse aussi bien de leurs spécificités socioculturelles que de leurs habitudes d’apprentissage et de leurs représentations linguistiques ». C’est la « centration sur l’apprentissage » par la prise en compte prioritaire des besoins d’apprentissage. Et citant Hutchinson et Waters (1987) :
« Nous devons regarder au-delà de la compétence qui permet à quelqu’un de communiquer, car ce que nous voulons véritablement découvrir ce n’est pas la compétence elle-même, mais comment on peut l’acquérir ».
Lehmann (1993 : 131-139) élabore cette notion de « besoins d’apprentissage » de manière à y inclure tous les besoins des apprenants au moment de l’E/A, et non seulement leur supposés besoin futurs, une fois l’apprentissage terminé. Il distingue deux types de besoins (les besoins dépendants et les besoins non-dépendants, op. cit. : p. 133-134), eux-mêmes composés de trois composantes :
- une composante psycho-affective, qui prend en compte le sentiment d’insécurité lié à toute situation d’apprentissage, sentiment qui peut être renforcé chez les adultes professionnels par l’idée que l’apprentissage est infantilisant ;
- une composante langagière, qui se décompose en trois domaines distincts : besoins liés à la communication dans la classe ; besoins liés à « la prise de conscience du fossé qui existe entre la classe et la communication réelle » ; enfin « un type de besoins lié en propre à l’apprentissage et dont on pourrait dire qu’il est le besoin de prendre la mesure de ce qui se joue dans l’apprentissage d’une langue » et qui touche aux représentations de l’apprenant sur le langage (cf. l’anglais « language awareness ») ;
- une composante socio-culturelle, qui doit englober une part de « la compétence particulière requise par la communication spécialisée », sans pour autant prétendre s’y substituer ou la reproduire totalement (il y a en effet des limites à « l’authenticité » dans les situations de classe).
Enfin, une autre voie possible est de s’extraire totalement de l’analyse des besoins, conformément à la proposition de Louis Porcher, pour qui il convient de
« sortir complètement de la problématique d’identification des besoins, qui se marque par une attention portée à la demande, pour se situer dans la problématique qui lui est symétrique, celle de l’offre de formation. Ceci ne veut évidemment pas dire que les besoins d’apprentissage n’existent pas, mais qu’il incombe à l’apprenant de gérer lui-même ses propres besoins au sein d’une relation entre l’offre et la demande qui a donc toutes les apparences d’un marché ».
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
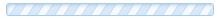
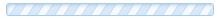
Bahasa lainnya
Dukungan alat penerjemahan: Afrikans, Albania, Amhara, Arab, Armenia, Azerbaijan, Bahasa Indonesia, Basque, Belanda, Belarussia, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Burma, Cebuano, Ceko, Chichewa, China, Cina Tradisional, Denmark, Deteksi bahasa, Esperanto, Estonia, Farsi, Finlandia, Frisia, Gaelig, Gaelik Skotlandia, Galisia, Georgia, Gujarati, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Ibrani, Igbo, Inggris, Islan, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Kannada, Katala, Kazak, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Klingon, Korea, Korsika, Kreol Haiti, Kroat, Kurdi, Laos, Latin, Latvia, Lituania, Luksemburg, Magyar, Makedonia, Malagasi, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Melayu, Mongol, Nepal, Norsk, Odia (Oriya), Pashto, Polandia, Portugis, Prancis, Punjabi, Rumania, Rusia, Samoa, Serb, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovakia, Slovenia, Somali, Spanyol, Sunda, Swahili, Swensk, Tagalog, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turki, Turkmen, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnam, Wales, Xhosa, Yiddi, Yoruba, Yunani, Zulu, Bahasa terjemahan.
- Good night~ ♡0 balasan 0 retweet 0 favor
- Long last
- Aku tidak sanggup
- Breathing Underwater"There's a light in
- Selamat malam ~ ♡ mimpi yang indah ya ?
- Breathing Underwater"There's a light in
- Jangan telat makan,agar tidak masuk angi
- Be great
- Left job
- membuatku makin hancur
- Breathe in breathe out
- Love Hurts"Love hurts, love scars, love
- membuatku makin hancur
- Like this
- Rainbow
- Something somewhere went terribly wrong
- membuatku makin hancurHasil (Inggris) 1:
- Beck in time
- Aku tahu kau mencintaiku cuma dengan sua
- wrong
- saya terima apa kata anda
- Your Love"I can never find the words to
- Good night~ ♡0 balasan 0 retweet 0 favor
- mengantuk, saatnya tidur. selamat malam

